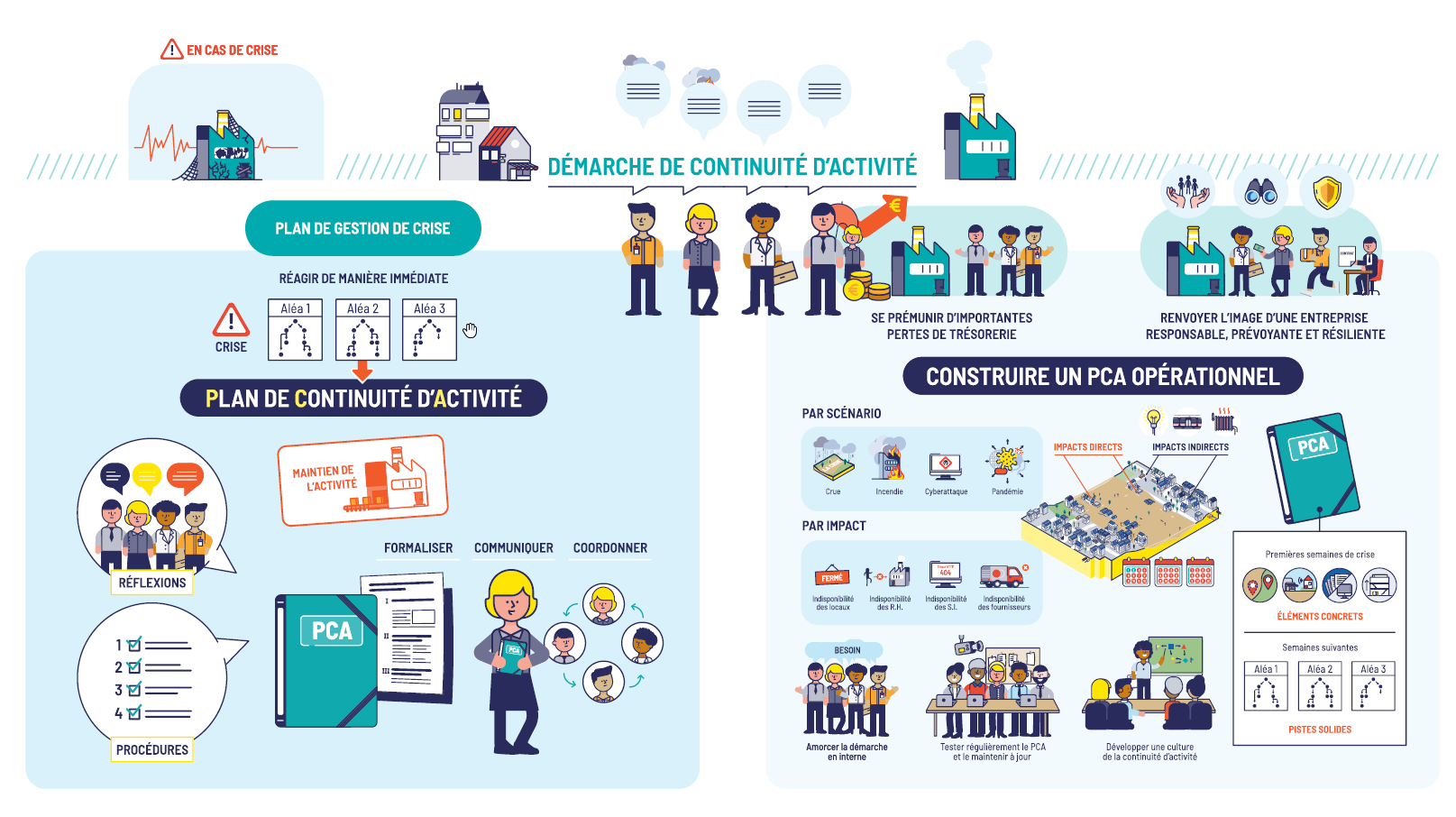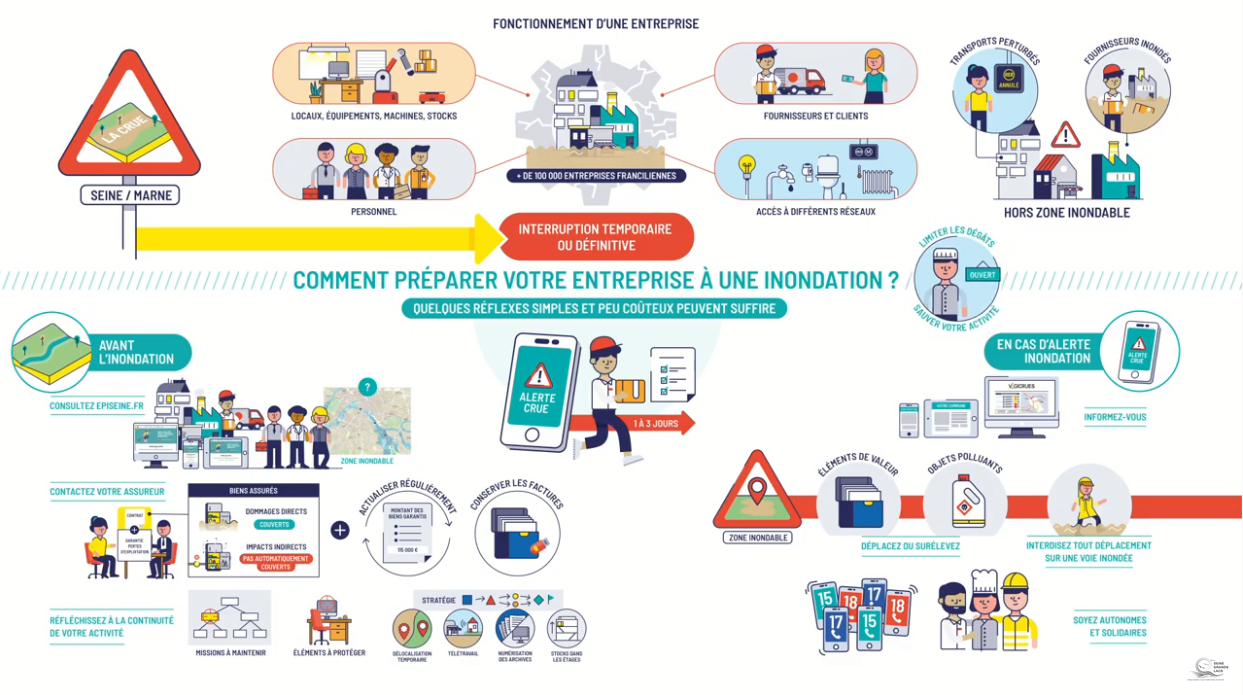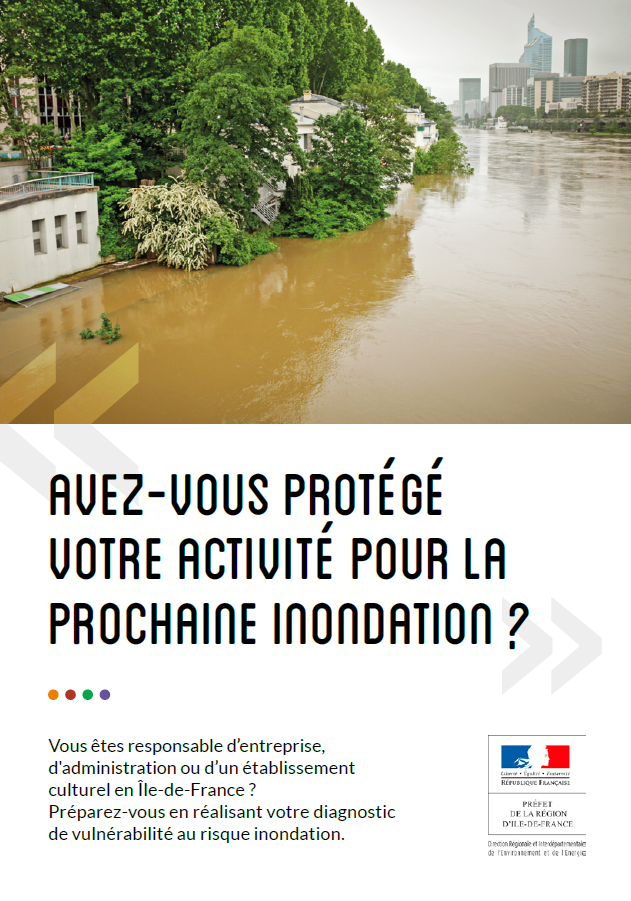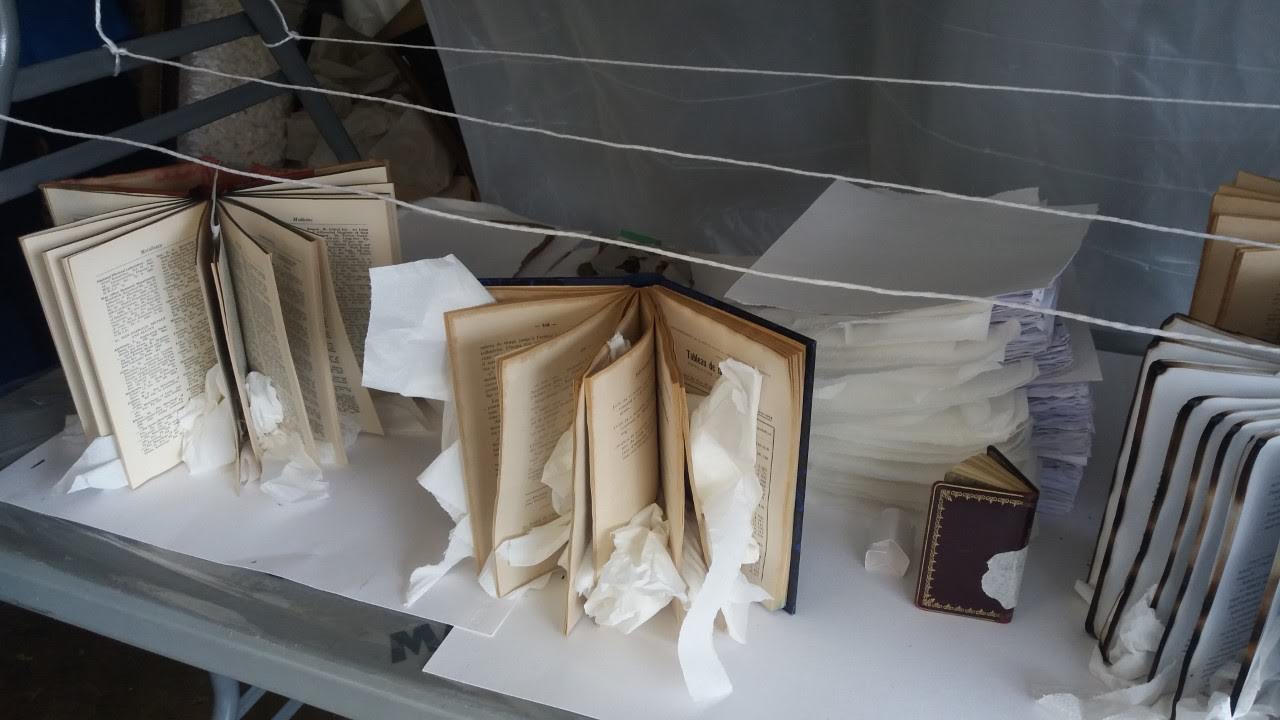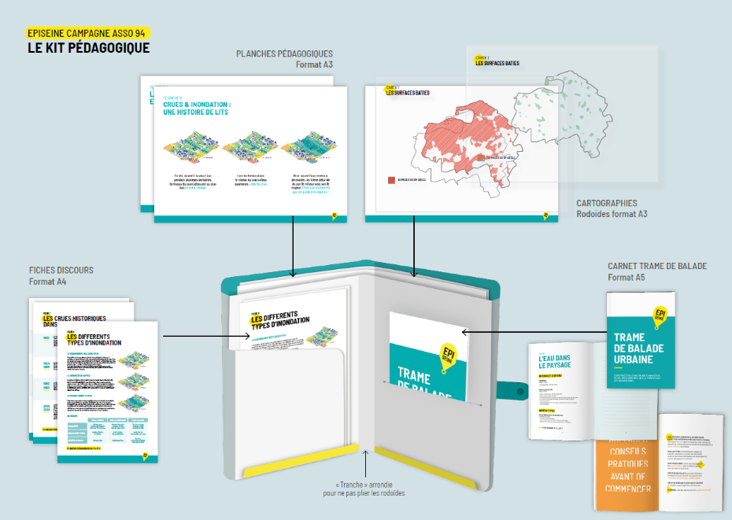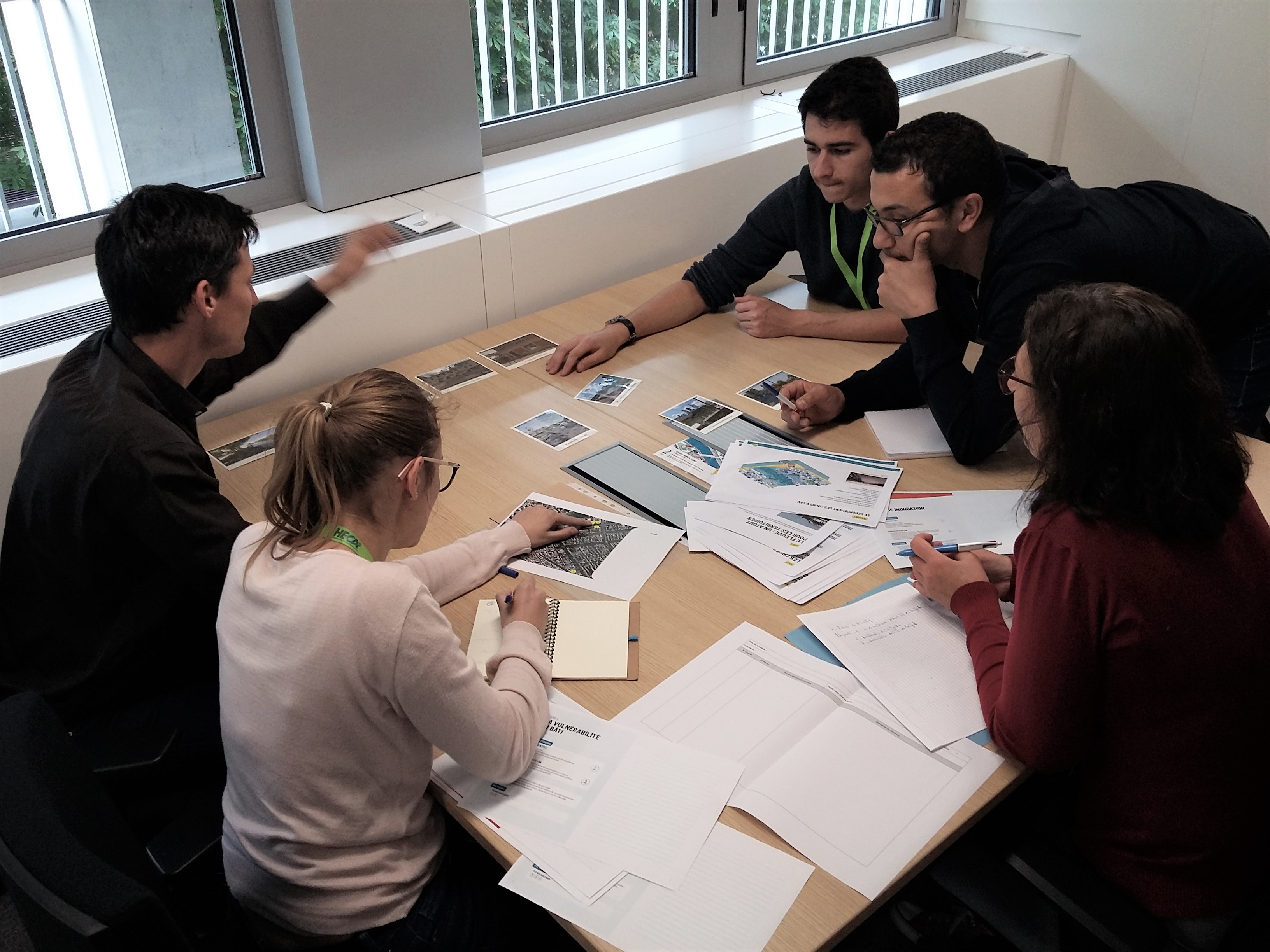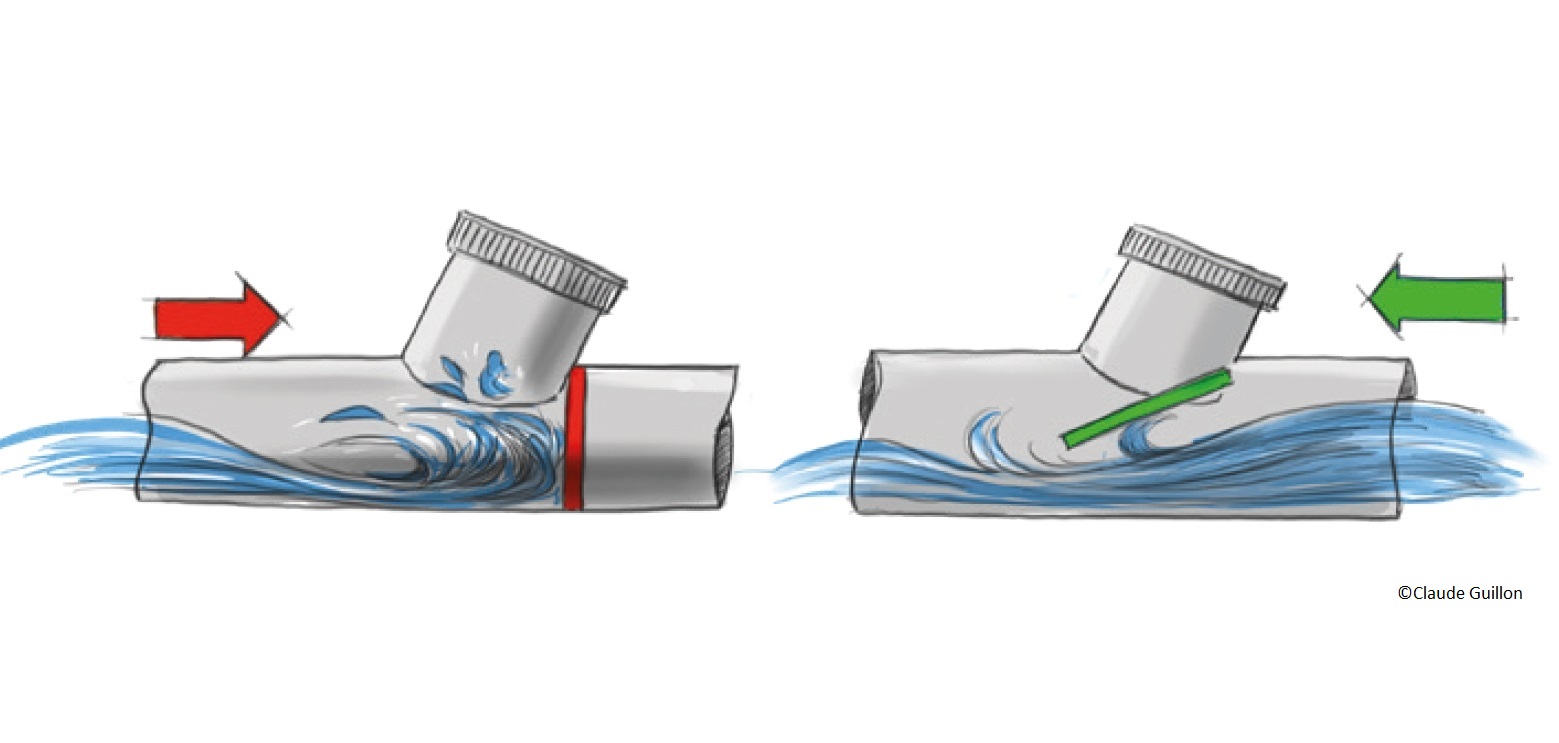Description
Un sondage, réalisé en 2017 par IPSOS auprès de 1 504 franciliens pour l’EPTB Seine Grands Lacs, a donné de nombreux enseignements sur leurs représentations du risque et leur rapport à la Seine.
Le sondage éclaire également leur niveau de connaissance et leurs attentes en matière d’information, les comportements qu’ils adopteraient en cas de crise et leur capacité à s’engager face au risque. C’est la première fois que les habitants de la région sont interrogés à une telle échelle sur cette thématique.
De manière globale, le sondage montre une différence entre la conscience des franciliens qu’une crue est inéluctable et leurs dispositions à s’engager ou à s’emparer du sujet. Cette relative passivité peut s’expliquer par une minimisation des conséquences des inondations et / ou par le transfert de la responsabilité sur d’autres, notamment les pouvoirs publics.
Les résultats du sondage ont été utilisés pour l’élaboration du diagnostic de la culture du risque inondation en Ile-de-France, par l’EPTB Seine Grands Lacs et ses partenaires.
Les franciliens ont une connaissance imprécise des crues…
85% des personnes interrogées ont entendu parler des inondations historiques, mais cette connaissance reste superficielle, souvent déconnectée de la réalité locale, et sans culture du fleuve. Cependant, 20% des enquêtés ont vécu l’expérience directe une inondation de grande ampleur, principalement sur leur lieu de résidence ou à l’occasion d’un voyage.
… et pensent qu’ils sont plus exposés qu’ils ne le sont en réalité
Une partie des franciliens interrogés surestime son exposition à une inondation. Alors que 7% de la population francilienne environ vit en zone inondable, soit 850 000 personnes sur une population totale de plus de 12 millions, 17% d’entre eux croient habiter en zone inondable.
Un risque qui va en augmentant selon eux
56% des personnes pensent que le risque inondation est plus important que par le passé, en particulier du fait du développement de l’urbanisation (63%) et du changement climatique (44%). Cependant, 38% de la population francilienne n’a pas conscience de ce risque, pourcentage élevé si l’on considère que deux crues de grande ampleur se sont produites lors des trois dernières années.
70% des franciliens estiment qu’ils sont mal informés
Les repères de crues sont bien connus (62%) ; viennent ensuite les lacs-réservoirs de l’EPTB Seine Grands Lacs, « Baignade interdite » et Vigicrues (40%). Entre 20% et 30% seulement des personnes ont déjà entendu parler du PPRI et de l’IAL, qui sont pourtant des dispositifs réglementaires obligatoires. Enfin, Sequana, le PCS et le DICRIM, VISIAU, le PFMS (Plan Familial de Mise en Sécurité) sont largement méconnus - 10% à 20% des sondés.
Alors qu’il y a une forte demande de communication…
80% de sondés souhaiteraient être mieux informés sur le risque inondation en général, en particulier ceux qui habitent en zone inondable ou qui ont déjà subi une inondation de grande ampleur. Plus de 80% souhaiteraient des conseils sur les comportements à adopter en cas d’inondation. Cependant, ces souhaits ne se traduisent pas en formulations précises des attentes en matière de communication.
… et de préparation à la gestion de la crise
Près de 90% pensent qu’il faut se préparer car la crue se produira certainement et 80% estiment qu’il faut s’organiser individuellement ou collectivement. Cependant, peu d’entre eux semblent prêts à s’engager.
Ils s’en remettent souvent à la construction d’ouvrages de protection et 40% délèguent totalement la gestion du risque aux pouvoirs publics. Si deux tiers des interrogés souhaitent participer à des réunions d’information, peu semblent prêts à s’investir au-delà de quelques réunions par an.